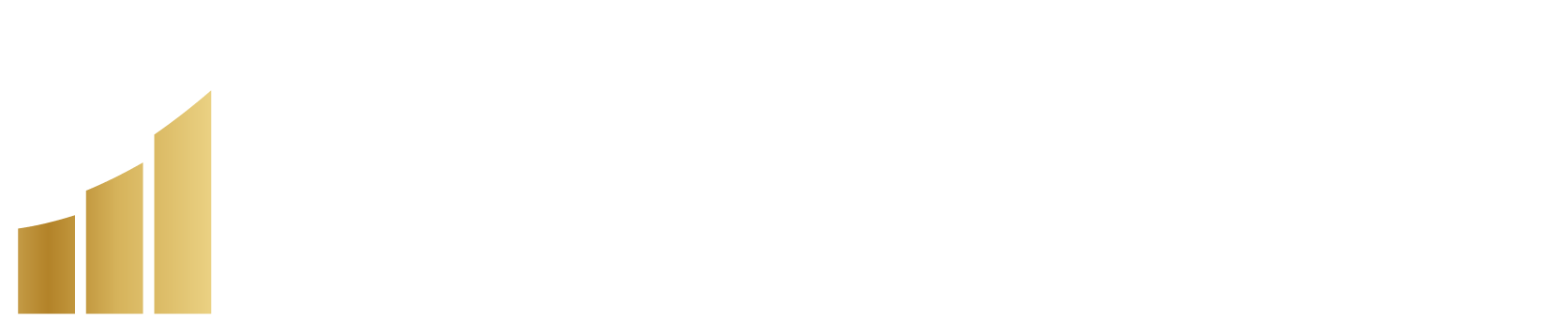Cher membre du Club,
En regardant cette vidéo vous ne verrez rien d’anormal :
Et pourtant, avant d’arriver sur la terrasse de cet immeuble, j’ai traversé un espace-temps unique : celui des derniers instants avant la faillite.
Qui m’a fait penser à l’épisode Lehman Brothers en septembre 2008 – et qui nous permet de voir l’état d’une partie du marché en 2024.
Des couloirs déserts et des bureaux abandonnés.
De rares employés au regard fuyant.
Des espaces de détente d’un vide glaçant


Postes de travail à l’abandon
Ici et là, quelques clients fidèles se croisent pour la dernière fois.
Car la fête est finie. Le compte à rebours avant la faillite de WeWork est lancé.
En soi, la liquidation d’une startup de bureaux partagés ne vous inquiète pas directement. J’espère que vous n’en êtes pas actionnaire.
Ce qui nous concerne, ce sont les mêmes symptômes présents chez de trop nombreux acteurs de la « tech ».
Voici ce qui pourrait se passer si la récession envoie la tech au tapis.
Quelle surprise : WeWork n’était pas rentable !
Et ne l’a jamais été. Du genre qui perd entre 2 et 4 milliards par an.
Et cette société a pourtant été introduite en bourse en 2020, avec un passif de pertes et sans aucune perspective de bénéfice.

Les pertes abyssales de WeWork
Il en va de même d’Uber (qu’on ne présente plus), de Snap (réseau social aux 750 millions d’abonnés), et de bien d’autres « licornes ».
Les licornes, ces startups dont l’unique objectif était de valoir plus d’un milliard – quelles qu’en soient les conséquences.
« Ça n’a jamais été le but de gagner de l’argent », me confiait récemment le fondateur d’une startup plutôt brillante.
Ça parait délirant – et ça a été réel pour 95% des entreprises « tech » entre 2014 et 2022.
J’indique cette période à dessein : JAMAIS dans l’histoire économique moderne, l’argent n’a été aussi abondant, grâce aux politiques des taux d’intérêt à zéro.

Et quand les taux baissent… Les levées de fonds de la tech augmentent ! Forcément, les investisseurs ont de l’argent à ne plus savoir qu’en faire.

Montant des levées de fonds en milliards de dollars
Et beaucoup d’investisseurs ont fait n’importe quoi.
Peu importe si le projet est rentable, pensez-vous ! Ce qui compte, c’est la vision, la technologie, l’ambition… jamais l’entrepreneuriat n’a été aussi dévoyé.
Entre 2014 et 2022, quiconque voulait « ubériser » un secteur (digitaliser au maximum les opérations pour réduire les frais de personnel et grossir vite) pouvait lever des fonds.
Le problème, c’est le terme « ubériser » : voilà bientôt 15 ans qu’Uber existe, et la société n’a toujours pas gagné d’argent.
Elle non plus. Et tant d’autres.
La partie visible de l’iceberg est malheureusement énorme
Pour les startups tech, la fête est finie depuis fin 2022, quand on a compris que la BCE et la Fed pratiqueraient des taux d’intérêt élevés – tuant dans l’œuf tout projet de levée de fonds.
Que les licornes fassent faillite, soit : elles n’ont jamais habitué quiconque à gagner de l’argent.
Mais il y a 3 problèmes avec ces canards boiteux de la tech, dont je parlais sur BFM.

#1 – WeWork va laisser 15 milliards de dette bancaire et locative en cas de faillite. Ce sont donc des banques et des propriétaires immobiliers qui vont y mettre de leur poche.
Multipliez maintenant la situation de WeWork par le nombre de startups dont les difficultés de financement ne s’arrangent pas avec les taux à 5% et la récession à venir aux USA.
Car si on parle des licornes cotées en bourse, songez à toutes les startups qui ne sont pas cotées : la banque Qonto, la banque N26, la plateforme Doctolib, les assurances Alan, les services de livraison à domicile, de location de vélo et trottinette électrique, etc.
Toutes ces entreprises sont financées par des fonds et des banques, qui gèrent – entre autres – nos retraites.
#2 – WeWork qui s’effondre, on peut penser que ses clients retrouveront des bureaux. Mais si des « néobanques » font faillite ? Si Doctolib est racheté à la casse ?
Que vont devenir les comptes bancaires des clients ? Qui va récupérer les données médicales des millions d’utilisateurs ?
La nature de certaines startups est inquiétante – notamment les néobanques (Revolut, Qonto, N26 pour celles que vous connaissez) qui se comptent par dizaines.
On a connu l’épouvantable crise bancaire de 2008 à cause de l’effet de contagion des banques qui rachètent les crédits des unes pour les revendre aux autres.
Et on a vu déjà 2 grosses faillites bancaires en 2023 : SVB (la banque des startups, quel hasard) et Crédit Suisse.
#3 – WeWork qui fait faillite, ça n’inquiètera pas les 7 « magnifiques » (celles que j’appelle les MAMATAN – Meta/Apple/Microsoft/Alphabet/Tesla/Amazon/Nvidia).
Je vous rappelle que sans ces 7 sociétés, l’indice global MSCI All Country Wide serait en pertes en 2023 au lieu d’afficher des gains de 4 %.
Mais si WeWork est suivie par d’autres géants déchus, cela va provoquer une réaction en chaîne comme suit :
- Meta (Facebook), Alphabet (Google) vont perdre de gros clients annonceurs. Amazon va perdre des clients sur la partie cloud (serveurs) ;
- En parallèle la « tech » va être sérieusement ébranlée en bourse, et ces 7 sociétés représentent 11 000 milliards de capitalisation – soit 10% à 15% du marché boursier mondial ;
- Ce qui se répercutera mécaniquement sur les indices, aggravant le phénomène « la tech tremble, donc les indices tremblent, donc la bourse tremble »
Au vu de ces 3 problèmes, il serait bon que WeWork soit un cas isolé.
La gestion est coupable, l’ambition responsable
Les médias qui titrent sur la « faillite du coworking » se plantent.
Une société de bureaux partagée comme Regus existe depuis 1989 et est entièrement profitable.
Dans le cas de WeWork, la folie des grandeurs des fondateurs a trompé les managers locaux.
Adam Neumann, fondateur de WeWork (en 2010) a cru que l’argent serait toujours abondant et a multiplié les acquisitions immobilières coûteuses, et les installations somptuaires dans toutes les grandes villes du monde.
Pour remplir les immeubles de bureaux, il a usé de politiques commerciales agressives – éloignées des bonnes pratiques en investissement immobilier (signature de baux longs, garanties bancaires, etc.).
Des conditions très favorables qui ont attiré les locataires les plus précaires : freelances et startups en amorçage.
Imaginez que pour accéder 7/7j et 24/24h à des bureaux au cœur de Paris, à leur terrasse, avoir des boissons chaudes et fraîches (dont des bières) à volonté, autant de consommables et de photocopies que l’on veut, il faut payer…
…300 euros par mois, soit moins de 15 euros par jour ouvré.

Performance de WeWork depuis l’introduction en bourse : –99,79% !
C’est peanuts !
Il y a une capacité d’environ 500 personnes dans le bâtiment. Le loyer annuel potentiel est donc de 300 x 500 x 12 = 1,8 million d’euros. Arrondissons à 2 millions d’euros. C’est ce que peut facturer WeWork pour ce bâtiment.
En face, le bailleur a acheté cet immeuble pour 190 millions d’euros. S’il pratique les loyers en place pour des bureaux à Paris, le loyer mensuel facturé à WeWork est d’environ 5,7 millions d’euros par an (un loyer qui lui rapporterait 3% en brut – ce qui serait déjà faible).
D’un côté WeWork gagne 2 millions, de l’autre elle doit payer 5,7 millions : problème.
Peut-être que ma règle de 3 est trop méchante. Mais pour que WeWork gagne au moins le montant du loyer qu’elle doit payer, elle devrait facturer 950 euros mensuels à chacun des 500 occupants !
Ce qui n’est pas du tout le cas.
Mais il y a plus grave : ma règle de 3 suppose que l’immeuble est rempli. Et le taux d’occupation des bureaux WeWork à Paris tourne autour de 60% : problème (bis).
Et pour ne rien arranger, les locataires de WeWork voient leur activité péricliter, puisqu’il s’agit surtout de startups qui vivaient sur des levées de fonds… bien plus rares aujourd’hui, et quittent les lieux progressivement : problème (ter).
Multipliez cette situation par les 777 emplacements de WeWork dans le monde et vous lirez très facilement le graphique du cours de bourse présenté ci-dessus.
Conclusion : de la délicate « ubérisation » de l’immobilier
Si un projet immobilier n’est pas tout de suite rentable, il y a peu de chance qu’il le soit un jour.
Car le secteur immobilier est par définition assez inerte. Il bloque beaucoup de capitaux, et embauche peu de personnel.
On peut croire aux miracles, mais l’innovation en immobilier n’existe pratiquement pas. On ne peut pas repousser les murs d’un immeuble.
On ne peut pas non plus trouver un système qui remplace les salariés : il n’y a presque pas de personnel pour gérer un immeuble.
Il faut donc partir avec un plan de trésorerie qui a « du gras » : bien plus de loyer que de charges et d’intérêts bancaires. Au moins le double, pour absorber les chocs (et il y en a beaucoup).
Car une fois signé, le bail ne bouge plus pendant 3 ans, parfois 6.
Et à titre personnel, si vous considérez un investissement locatif, la logique est la même : ne comptez pas sur un retour à la rentabilité si vous partez avec 2 ou 3 ans de pertes au départ.
Ce n’est pas donné à tout le monde de gérer correctement des investissements immobiliers.
Sous peu, je vous présenterai un placement « star » en immobilier, le seul que j’utilise depuis 15 ans.
Et le seul qui me rapporte plus de 10% par an.
À très vite donc,
Felix Baron